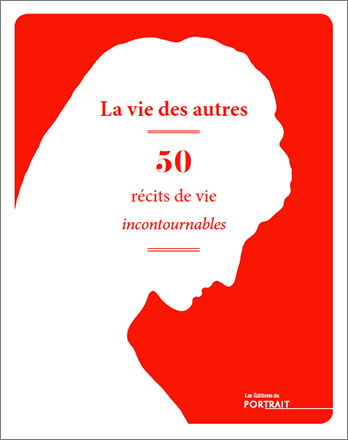Paru en 2015
Contexte de parution : La vie des autres (Portrait)
Présentation :
8 portraits réalisés pour le livre de la revue Portrait : La vie des autres (publié en 2015).
Sujet principal : Alain Cuny, Alfred Jarry, Arthur Rimbaud, August Strindberg, Christian Gabrielle Guez Ricord, Daniel Paul Schreber, Enid Sarkie, Hester Albach, Jean-Pierre Coudray, Léona Delcourt, Patrick Besnier, Pierre Minet, René Daumal, Roger Gilbert-Lecomte
Cité(s) également :
1) Hester Albach, Léona héroïne du surréalisme
Au début du XXIe siècle, Hester Albach est à Paris. Elle est obsédée par Nadja d’André Breton, qu’elle relit sans cesse. Et elle commence à s’interroger sur le modèle du livre, cette femme que le poète rencontre le 4 octobre 1926 rue Lafayette, et dont des propos contradictoires disent alternativement qu’elle est un personnage de fiction ou qu’elle a véritablement existé. 27 lettres de « Nadja » sont mises aux enchères lors de la vente André Breton de 2003, accréditant la seconde thèse, et la romancière néerlandaise se met à enquêter sur cette être étrange, incarnation du surréalisme vécu, à la fois muse, poète sauvage et voyante. Elle retrouve sa petite fille Ghislaine, retrace son parcours de sa naissance en 1902 à sa mort en 1941, et confronte la réalité des quatre mois et demi que Léona Delcourt vécut dans l’amour de l’écrivain aux neuf dépeints par André Breton. Le récit est terriblement beau, mais surtout terriblement triste. Si Breton trouve dans Nadja la matière d’une œuvre au noir qui transforme la vie en beauté convulsive, André n’aime pas Léona. Et il s’éloigne d’elle, alors que l’amour fou qu’elle lui porte lui rend sa vie irrespirable. L’amour n’a pas le même coût pour tout le monde. « J’ai perdu, c’était prévu, n’est-ce pas ? » écrit Léona consumée, alors que Breton commence à rédiger son livre. Le 7 janvier 1927, Breton assiste à une séance du médium Pascal Forthuny Celui-ci lui dit qu’il a fait souffrir une jeune fille du fait se sa dureté, et qu’il l’a plongée dans un cruel drame de conscience, et il ajoute, énigmatique : « Le temps a fait son œuvre ». Encore obsédé par le poète, Léona succombera au délire et fera un scandale dans son hôtel quelques mois plus tard, à la suite de quoi la patronne de celui-ci la fait interner. Léona aboutit dans l’asile de Bailleul, où elle restera enfermée jusqu’à sa mort en 1941. Nous n’aurons pas assez de larmes pour expier la souffrance de la seule surréaliste authentique, et qui le paya au prix fort : Léona « Nadja » Delcourt.
2) August Strinberg, Inferno
En 1894, un dramaturge suédois est à Paris. Il est en train de se séparer de sa deuxième épouse, Frida Uhl : « Je l’aime, elle m’aime, et nous nous haïssons d’une féroce haine d’amour qui s’accroît par l’absence. » Il l’accompagne à la Gare du Nord où elle prend son train et il revient dans sa chambre, très content d’être enfin seul. Pour écrire ? Non. Pour prouver la présence de l’hydrogène et de l’oxygène dans le souffre. Cet homme, c’est August Strindberg, un écrivain qui n’a cessé de vouloir être autre chose : acteur, historien, spécialiste en civilisation chinoise, anthropologue, musicien, peintre, scientifique… Il est venu à Paris où il est joué sur une scène nationale, mais le théâtre le dégoute plus que jamais. En correspondance avec Jollivet-Castelot, il s’aventure sur un terrain flou entre la chimie et l’alchimie, et commence à être attaqué par des visions qui le dépassent. Paris est dépeinte comme la ville maudite que nous connaissons : « l’horrible rue de la Gaité », « la rue Delambre, morne et silencieuse ». Et puis quelque chose de plus grave et de plus terrible se présente, « un secret que mon propre tombeau révélera peut-être » et dont l’écrivain ne peut parler qu’à mots couverts. Parmi les fréquentations de cet expatrié de luxe, deux hommes : un marchand de tableaux, Willy Gretor, et un éditeur, Albert Langen, s’imposent comme ses impresarii. Strindberg se rend compte que les deux hommes ne sont pas seulement des escrocs, des trafiquants de faux tableaux, mais également des assassins, et son livre nous le dit sans le dire, le laisse transparaître dans des passages mystérieux, faisant passer pour des hallucinations liées à la folie un crime – la mort mystérieuse de Héloïse – dénoncé à mots couverts : « Rue Chauveau-Lagarde, derrière l’église de la Madeleine ! L’assassinat mystérieux d’une vieille dame… en… 1893… Rue Chauveau-Lagarde… rouge de sang coagulé… sans que les deux assassins fussent découverts ! » Inferno devient le journal de bord de la compréhension du fonctionnement crypté du monde : « Nous sommes déjà dans l’enfer, y écrit Strindberg. La terre, c’est l’enfer, la prison construite avec une intelligence supérieure. »
3) Daniel Paul Schreber, Mémoires d’un névropathe
Nous sommes à la fin du XIXe siècle. Un très grand magistrat de Dresde, Daniel Paul Schreber, à la suite de l’obtention du poste de président de chambre d’appel, se réveille avec l’idée que ce doit être une très grande chose que d’être une femme en train de jouir. Il fait une dépression nerveuse et se retrouve dans un hôpital avec un très mauvais médecin, le docteur Flechsig, qui pratique la castration thérapeutique. Schreber est persécuté par des voix qui s’insinuent dans sa tête et lui expliquent que Flechsig a réalisé sur lui un meurtre d’âme, c’est-à-dire une action consciente de télé-hypnose. Schreber finit par sortir d’asile au tout début du XXe siècle en publiant son autobiographie, faisant passer ce qu’on appelle ses folies pour des croyances religieuses singulières. C’est un roman de science-fiction vécu ; une autobiographie avec le rythme et la logique d’un film d’horreur. Annonçant à la fois Antonin Artaud et Philip K. Dick, le magistrat écrit des phrases d’une poésie incroyable, dont on ne sait si on doit les associer à la folie ou à la plus grande lucidité : « Je peux admettre que la croyance populaire selon laquelle les feux follets sont des âmes défuntes correspond dans bien des cas, sinon dans tous, à la réalité ; je pourrais parler des « horloges errantes », c’est-à-dire des âmes d’hérétiques défunts, dont il était dit qu’elles avaient été conservées pendant des siècles sous des cloches de verre dans des couvents du Moyen-Âge (à cela aussi, quelque chose comme un meurtre d’âme avait dû être mêlé) et qui manifestaient qu’elles vivaient encore, par une vibration accompagnée d’un bourdonnement funèbre infiniment monotone (j’en ai expérimenté l’impression moi-même par la voie des branchements de raccordements de nerfs), etc. » Dans Mémoires d’un névropathe, on trouve un dieu schizophrène en lutte contre lui-même, Ormuzd-Ahriman ; une humanité exterminée par erreur par Dieu et remplacée par des images d’hommes bâclés à la 6-4-2 ; enfin Daniel Paul Schreber, le « plus grand visionnaire de tous les millénaires » (ce sont les voix qui parlent dans sa tête qui le disent ; pas lui), un juge allemand se transformant successivement en juif et en femme – mais jamais complètement, et de façon presque imperceptible – pour accoucher d’une nouvelle humanité, et nous annonçant, à travers des visions empathiques, le terrible XXe siècle.
4) Alain Cuny, Le désir de parole (conversations avec Alfred Simon)
Un critique de théâtre, Alfred Simon, devient ami avec Alain Cuny – un des deux plus grands acteurs français de son temps avec Roger Blin ; un des deux qui aient été vu et élu par Antonin Artaud, alors qu’ils avaient 18 ans et qu’il montait sa pièce unique, Les Cenci. Depuis, Alain Cuny est devenu un des comédiens les plus rares : 21 pièces de théâtre, 20 films. Mais pour toutes et tous, il est inoubliable. Il a été Orphée, Macbeth, Tête d’Or, le comte dans On ne sait comment de Pirandello, le colonel de La Danse de mort de Strindberg, le trouvère des Visiteurs du soir, Steiner dans La dolce vita, le diable de La voie lactée, le chef indien de Touche pas à la femme blanche. Pendant que Alfred Simon fait écrire son livre à Alain Cuny, ce dernier prépare L’annonce faite à Marie – un film que la famille Claudel lui a demandé, et qu’il mettra vingt ans à réaliser. Au fil de déjeuners complices dans le hameau du premier, près de Gisors, l’acteur se met à parler. Et il dit des choses extraordinaires. Tout d’abord, sur l’inutilité du metteur en scène : « personnage dont le théâtre s’est passé pendant des siècles, n’ayant besoin que d’un régisseur, voire d’un souffleur. » Sur son visage et son jeu : « Je voudrais irradier comme un galet, comme une pierre. Je voudrais que mon visage ne soit qu’un masque. » Et l’influence sur lui du théâtre Nô : « Cette inscription, si ralentie et si réduite, qui donne aux gestes leur extension, par laquelle on parvient à cette appréhension presque impossible de soi, dans la mesure même où tout se réduit à si peu, mais ce peu-là est à la limite du Tout. » Il parle d’Artaud, de Claudel et même du sexe : « L’amour, ce rendez-vous avec le frémissement de la vie organique, est à la vie ce que le glas est à la mort. J’ai du mal à exprimer cela parce que j’entends déjà ricaner le mâle français, qui se fait gloriole, dans le monde, de sa grivoiserie que je hais. » Alain Cuny a tout pris au sérieux ; en retour, tout prend Cuny au cœur de son être. Sa parole est si forte que, sur le moindre sujet, il pique et fait mouche et produit une succession d’épiphanies cruelles. Nous avons tous en nous le visage de Alain Cuny qui nous regarde et sa voix qui nous parle comme le dieu de notre conscience. Nous ne serons jamais aussi exigeants que lui, mais comme Giacometti, comme Beckett, il reste un exemple de ce que l’ascèse seule sait produire chez un être, un exemple de ce que peut un homme lorsqu’il va chercher son art à la racine de l’être humain.
5) Christian Guez/ Jean-Pierre Coudray, Du fou au bateleur
En 1974, un poète hospitalisé, Christian Gabrielle Guez Ricord rencontre Jean-Pierre Coudray, un psychiatre qui doit le soigner et avec qui il va nouer une relation qui ira bien au-delà de celle du patient et du médecin. Entre eux commence un récit, à deux voix, sous la forme d’un dialogue où l’on remonte les cartes du Tarot, du fou au bateleur, et qui forme la matière d’un des plus beaux livres d’amitié qui soit. Tout commence par un grand chagrin d’amour que raconte Guez : au début de son existence d’adulte, Christian tombe amoureux de la fille d’un grand écrivain, Catherine Camus ; celle-ci va se marier et Guez, désespéré, pense qu’il doit se tuer pour se réincarner en elle, être son enfant. Guez est plongé dans L’Apocalypse, le Tarot, la Kabbale. Il croit que les chansons d’Aznavour qui passent à la radio s’adressent à lui. Quelques années plus tard, il essaiera d’incarner le diable, et, en se tuant, de débarrasser le monde du Mal. En mai 1968, il est à Lourmarin et il veut monter à Paris, mais il n’y sera qu’en juin, et il y interprète les signes des temps. Guez part à Strasbourg, il veut être opéré : faire le don de son cœur au général De Gaulle pour le rajeunir et le sacrer Roi de France. Par moments, il est parcouru d’angoisses : il commence à croire que tous ses amis sont des nazis. On lui offre un gâteau et il pense qu’on y a transsubstantié toutes les œuvres du marquis de Sade. Face au récit de Guez, Coudray se dit « comme un ethnologue à l’écoute de la vision du monde d’un sage exotique ». Il le comprend et le raisonne sans jamais l’humilier. Coudray écoute Guez, et Guez entend Coudray : « Une de tes phrases a joué un grand rôle thérapeutique, dit le poète visionnaire. C’est lorsque tu m’as dit : On peut se prendre pour Napoléon. Ce qui est pathologique, c’est de dire à son épicier : Je suis Napoléon, faites-moi crédit. L’épicier n’est pas forcé de se prendre pour un grognard. » Parfois on ne sait plus qui est le poète et qui est le médecin. Et parfois on se dit que l’humanité peut se mettre à l’écoute d’elle-même, comme si le cerveau gauche se mettait à l’écoute du cerveau droit, et réciproquement. Parfois on a un peu moins honte d’être un homme.
6) Pierre Minet, La défaite
C’est quoi réussir sa vie ? Pierre Minet pense qu’il a raté la sienne. Il a deux exemples de grands foudroyés, morts devant ses yeux, qui le ramènent invariablement à son échec. Il leur a survécu. Il n’est pas devenu poète. Il vit ça comme une lâcheté. Face à l’absence de René Daumal et de Roger Gilbert-Lecomte, sa vie n’est plus qu’une ombre. « Les meilleurs sont morts. Tant mieux pour eux. Mais leur disparition me pèse ; elle rend ma solitude parfois terrifiante. » Son témoignage date de 1947, alors que Minet a 38 ans. Grace à ce témoin exemplaire, on entre dans la vie intime de deux poètes mystiques géniaux, qui ont fait de leur vie une métaphysique expérimentale quotidienne ; une existence en apesanteur entre les caves du ciel et le plafond de l’enfer. L’adolescent Minet était camelot du Roi et vendait L’action française quand Daumal et Gilbert-Lecomte viennent le chercher, un 1er mai 1925 à Reims. Ils lui tapent sur l’épaule, lui sourient (Daumal sort un mouchoir et essuie même les perles de sueur sur le visage du jeune homme) et ces deux héros le tirent littéralement de l’impasse nationaliste pour l’emmener sur d’autres rives, celles de la poésie absolue. Par eux, Minet découvre Rimbaud, Lautréamont, Nerval. Daumal et Minet font des exercices de mystique potache dans les nuits parisiennes : le raccompagnant chez lui, Minet ferme les yeux et marche guidé par la voix de Daumal : « Attention, il y a un trou ! » Daumal parfois l’emmène à l’aveugle loin de chez lui. Quand Minet ouvre les yeux, il est face à Notre-Dame ou au Panthéon. « Je questionnais Daumal mais il ne se souvenait pas bien ; ses yeux étaient allés sans lui qui partageait à présent mon dépaysement. » Minet est ébloui. Mais devant l’auto-destruction de Gilbert-Lecomte, plongé dans la morphine et la misère, écrivant de moins en moins et succombe au tétanos en 1943, comme devant l’ascèse de Daumal, qui meurt de la tuberculose en 1944 après avoir laissé inachevé le grand récit initiatique du XXe siècle, Le mont analogue, le jeune homme renonce à les suivre. « La pensée de Gilbert-Lecomte comme de Daumal n’éprouvait plus le besoin d’une consécration extérieure. L’un et l’autre regardaient le monde les yeux clos. L’un et l’autre savaient que la voie où il s’étaient engagés les mènerait, s’ils persévéraient, en des lieux bien autrement hostiles, et qu’il eût été déraisonnable d’épuiser leurs forces contre un état de choses auquel décidément ils tournaient le dos. Je les adorais, ils étaient mes dieux. » Les poètes du Grand Jeu ne sont pas des dieux, mais des anges. Si ils ont tourné le dos aux choses du monde, nous devons leur ouvrir nos cœurs. Nous devons comprendre l’importance de leur parole comme de leur exemple ; ou alors, comme Minet, nous en aurons « gros sur la patate ».
7) Enid Sarkie, Arthur Rimbaud
Il y a eu autant de Rimbaud que Rimbaud a eu de lecteurs. Quel rapport entre celui de Claudel et celui de Breton ? Celui de Gilbert-Lecomte et celui de Henry Miller ? Burroughs et Dylan ? Aucun et beaucoup. Chacun a eu le droit de lire le message prophétique qui lui était confié dans la poésie visionnaire de celui qui disait : « Tout est vrai et dans tous les sens ». Le Rimbaud d’Enid Sarkie est le mien. C’est dans la biographie de cette américaine que j’ai appris les deux ou trois choses qui éclairèrent pour moi définitivement son très obscur et magnétique parcours. Comment expliquer le changement d’état de cet enfant gentil, enthousiaste, surdoué – sorte d’élève modèle rallié aux idéaux de la Commune – et le jeune homme cruel, manipulateur, qui s’acharne contre Verlaine, lui réécrit, le rattrape quand il fuit pour l’enfoncer encore un peu plus ? L’incompréhension de Georges Izambard à la réception du Cœur supplicié, joint à la lettre du 13 mai, peut l’expliquer. Izambard était le jeune et génial professeur de Rimbaud, qui nourrit l’intérêt de l’adolescent pour les poètes modernes et, quand Rimbaud fuguait pour tenter de rejoindre les communards, c’est ensuite vers Izambard, ou chez les tantes d’Izambard qu’il échouait pour qu’elles lui ôtent les poux attrapés en prison. Mais lors de son séjour à la caserne Babylone, il fut soumis à un traitement dont il n’arrivait à parler qu’indirectement, une expérience traumatisante entre toutes que Le cœur supplicié n’arrive à exprimer qu’à mots couverts : « Mon triste cœur bave à la poupe… Mon cœur couvert de caporal (…) Sous les quolibets de la troupe / Qui lance un rire général (…) Quand ils auront tari leurs chiques / Comment agir ô cœur volé ? Ce seront des refrains bachiques (…) J’aurais des sursauts stomachiques » A-t-on compris ce que ce groupe de soudards fit subir au jeune adolescent androgyne ? Comprend-t-on pourquoi Rimbaud a des sursauts stomachiques, que son cœur bave à la poupe, que la troupe lance un rire général, et, une fois taris leurs chiques, chante des refrains bachiques ? Izambard visiblement non, et il répondit à ce poème étrange par une parodie. Non seulement Rimbaud se détourna d’Izambard mais il ne fut plus jamais le même : « Il était une autre personne à son retour à Charleville » dit Sarkie. Et puis la biographe éclaire la dimension symbolique, ésotérique, qui naît de la rencontre avec un personnage fascinant, Charles Bretagne, un fonctionnaire des douanes, anarchiste, jovial et grand connaisseur d’occultisme et de magie. Un homme de Charleville dont Rimbaud appréciait la compagnie et qui l’introduit aux motifs alchimiques qui parsèmeront son œuvre. Pour toutes ces raisons, et pour tant d’autres, cette grosse biographie est mon Rimbaud de poche, à emporter partout, à consulter toujours. On n’est jamais assez sérieux quand on est rimbaldien.
8) Patrick Besnier, Alfred Jarry
Né en 1873, c’était l’homme le plus drôle et le plus mystérieux au monde. A la fois modèle revendiqué des avant-gardes (Apollinaire, Marinetti, Dada, etc.) et obsessionnel réinventeur de l’esprit de l’enfance (amateur de marionnettes, de petits jouets pour enfants, de théâtre désuet), héritier de la poésie symboliste et de l’esprit du Mercure de France et incarnation de l’homme sauvage, « homme à la hache » et inventeur de la pataphysique : Alfred Jarry lui-même. Un jour, dans un jardin de Corbeil, il s’amuse à déboucher le champagne en tirant sur le bouchon avec son revolver. La propriétaire de la villa voisine s’inquiète, elle vient dire à l’écrivain que ses enfants auraient pu être victimes de son arme à feu : « Qu’à cela ne tienne, madame, répond Jarry, nous vous en ferions d’autres ». Jarry sort régulièrement son arme à feu pour tenir en joue un interlocuteur. A Apollinaire avec qui il passe une soirée chahutée, il lui dit : « C’était beau comme littérature, non ? » Mais Patrick Besnier nous le démontre : cette personnalité folle et drôle était un masque, une « persona » que l’auteur a inventé, dans un mélange de stratégie littéraire, de protection psychique et de provocation cosmique. Qui était vraiment Alfred Jarry ? L’homme qui a écrit Ubu roi, Ubu cocu, César-Antéchrist, Les jours et les nuits, Docteur Faustroll, Le surmâle, soit les textes les plus fous, les plus violents, les plus étranges et les plus consolateurs de son temps est un individu à la vie si secrète qu’on ne lui connaît avec certitude aucun amour ; un homme qui n’est pas complètement de ce monde et qui n’a pas encore été absorbé par l’autre. Un an avant sa mort, Jarry fait l’impossible : il voyage dans l’autre monde, et il revient, écrivant à mi-chemin de celui-ci son dernier livre, La dragonne, qu’il dicte à sa sœur Charlotte avant de traverser définitivement le rideau troué de la nuit des Temps en 1907. Depuis, Jarry se tient, épée en main, entre les mondes, tenant en joug les anges et le Diable. Et son œuvre est notre dernière Bible – elle nous protège parce que, tant que nous ne l’aurons pas comprise, le monde est encore suspendu et tout n’est pas encore définitivement impossible.