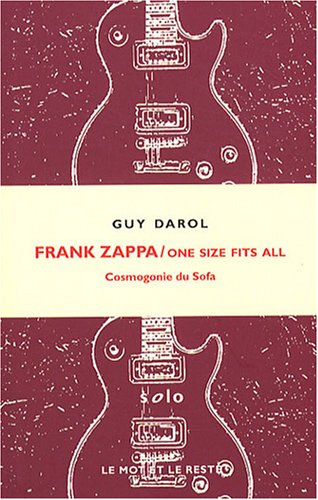Paru en 2008
Contexte de parution : Le nouvel Attila
Présentation :
Texte à propos de Frank Zappa/One Size Fits All – Cosmogonie du Sofa de Guy Darol.
Sujet principal :
Cité(s) également :
Le détournement des principes alchimiques dans le modus operandi de la « Continuité Conceptuelle » est un des pans les plus inquiétants de l’œuvre de Zappa. Le morceau But who was Fulcanelli ? sur Guitar a initié une enquête longue et délicate ; une célèbre interview de David Ocker également, dans lequel ce dernier confie : « Je me suis toujours demandé qui était Fulcanelli à partir du jour où j’ai entendu Frank prononcer son nom comme réponse à la question « Quel personnage historique auriez-vous aimé rencontrer ? » (alors, j’avais écrit son nom sur un post-it pour que je ne l’oublie pas et le post-it est toujours sur mon bureau à l’instant où je vous parle). » La question de l’identité de Fulcanelli est le pont-aux-ânes de la spéculation philosophale : elle occupe aussi bien des ouvrages de pop-occultisme tels que Le Matin des Magiciens que les études d’historiens plus rigoureux, et va jusqu’à infuser les recherches trans-disciplinaires d’André Breton ou de Carl Gustav Jung. Fulcanelli est généralement considéré comme le plus grand alchimiste du XXe siècle, et ce, malgré le fait que notre connaissance concrète de l’homme s’arrête à celle de deux ouvrages d’études de symbolique architecturale, Le Mystère des Cathédrales et Les Demeures Philosophales, études nourries, il est vrai, d’une connaissance du Grand Œuvre dont la légende veut que, l’auteur l’ayant réalisé, celui-ci a acquis le don d’immortalité.
Rétroactivement, c’est toute la discographie de Zappa qui semble répondre à un principe unificateur mystérieux, un filtre étrange qui permet à l’ensemble des éléments hétérogènes qui le composent de ne cesser de produire du sens, à l’intérieur comme à l’extérieur de ses disques. Dans le célèbre entretien avec Bob Marshall du 22 Octobre 1988, Zappa n’a pas hésité à citer La Table d’Emeraude d’Hermès Trismégiste (« Ce qui est en haut est comme ce qui est bas ») pour définir son travail. Comme l’écrivain énigmatique et hautain de L’Image dans le tapis d’Henry James, Zappa prévient inlassablement ses auditeurs que ce qu’il est en train de faire ne veut pas ne rien dire. Son corpus possède une dimension totalisante qui apparaît comme l’« image parfaite d’une intention » – et tous ses auditeurs passionnés savent qu’il n’est pas une journée qui se déroule sans qu’un élément tiré du hasard de leur quotidienneté ne leur renvoie à un aphorisme louche ou à une mélodie baroque et interrogative du maître. Que cette opération soit le pur produit de l’inconscient – et la rare capacité de Zappa à sculpter l’espace intermédiaire qui sépare l’inconscient de la conscience – ou qu’elle naisse de la façon dont l’Univers fonctionne réellement (« que nous le comprenions ou non ») nous renvoie immédiatement à la question de nos croyances fondamentales sur le sens de la vie, et est susceptible de débats interminables. La réalité de la « Continuité Conceptuelle » comme modus operandi a elle-même été remise en question par de patients exégètes, dont la traque de signes univoques s’avéra stérile – à la manière de ces théologiens que l’étude des Écritures rendit définitivement fous : « Pendant des années, a pu écrire Dirk Manuel dans le fanzine T’Mershi Duween (cité par Ben Watson), j’ai passionnément « consommé » de vastes quantités de matériel zappien, je m’y suis absorbé autant que possible dans le vague espoir qu’un jour je finisse par comprendre ce qu’était sa légendaire « Continuité Conceptuelle ». Finalement, après tout ce temps à écouter ses disques et à explorer ses pochettes, je crois… que ces théories furent élaborées pour manipuler l’industrie musicale dans l’objectif que celle-ci imagine Frank sur un plan supérieur et y voit une raison de lui accorder une considération particulière (presse, publicité)… En fait, Frank se fout de notre gueule. »
Bien sûr, il est parfaitement vain de discuter de l’existence ou la non-existence de cette technique d’unification – aussi vain que poser la question de l’existence de Dieu ou celle de l’inconscient – puisque, en tant que principe invisible, on ne peut en mesurer que les effets. Ce sont ses effets, et leur propension à produire du sens dont on peut parler. Ce qui compte, donc, c’est que cette musique fonctionne à échelle individuelle comme support de réalisation. Et que ce support soit celui d’une réalisation tératologique, monstrueuse (ce que Zappa nous apprend, avant tout, c’est à bander pour les monstres, pas pour les gens mignons) partant systématiquement des accidents comme matériau et non de symboles patiemment composés. « La continuité conceptuelle n’est pas un contrôle total – comme Zappa aimerait le laisser entendre – mais renvoie plutôt à un usage dialectique de l’accident. » (Ben Watson) Cosmogonie du Sofa, le bref mais très dense ouvrage de Guy Darol, vient ouvrir avec la violence d’un rideau de théâtre cette scène étrange dont les images sont pour nous d’autant plus prégnantes qu’elles restent à ce jour profondément énigmatiques.
Chaque album de Zappa est un rendez-vous. Sa première écoute se présente comme une remise en cause de tout ce que nous pensons que sa musique est (et par extension, de la manière dont nous envisageons le fonctionnement de l’Univers) ; et One Size Fits All est peut-être l’apothéose de cette méthode. Dès la première page de son livre, Guy Darol, reprenant le style mélodique et mélancolique de la Parade de l’Homme-Wazoo, nous décrit l’état émotionnel de l’auditeur de Zappa, attendant l’advenue de cet album de 1975 « comme une pierre d’alchimie ». Les apparitions et disparitions de Oh No dans le corpus zappéen (son entrée désarmante de bonheur dans Lumpy Gravy, son retour ironique en diable dans Weasels ripped my flesh) sont comparées à celles d’un oiseau. Car il s’agit bien pour Darol d’un langage diplomatique, et donc de l’intégration progressive chez l’auditeur d’un autre langage, d’une autre manière d’être au monde. « Ecouter devient chose sérieuse ». Il y aurait tant à décrire sur la spécificité de l’auditeur de Frank Zappa, déjà interprète, déjà exégète et explorateur, et sur l’invention d’un nouveau type d’humain, à la fois intellectuel passionné et grand vivant, dont le sérieux n’omet jamais – comme le rêvait Nietzsche – l’humour le plus décapant. Frank Zappa était un politicien beaucoup plus modéré que sa musique. Alors qu’il se présentait comme un « conservateur pragmatique » les auditeurs que sa science folle a engendré sont les dignes enfants des Marx Brothers : destructeurs et créateurs, séducteurs d’une brutale sincérité, freaks baroques traversés d’états extatiques.
C’est Michel, l’ami décrit par Darol dans Cosmogonie du Sofa, qui insiste sur les relations entre l’univers zappien et l’alchimie. « Les diagrammes, la carte du ciel projetaient des pistes dont la signification ne pouvait apparaître sans une connaissance précise des données hermétiques. (…) Michel était brusquement convaincu qu’en déchiffrant l’ordonnance des signes, nous atteindrions l’état de félicité absolue. » Cette esthétique de l’alchimie, Zappa la croise avec un intérêt pour les conséquences pratiques de la science moderne. Ainsi, son autobiographie est dédiée à Koko le gorille qui parle et à Stephen Hawking, pour qui « un renversement de la flèche du temps est possible ». Au cœur du livre, Darol traite d’un des pôles du projet de Zappa : donner pleine consistance à son hypothèse cosmologique, celle de la Grande Note, correspondant à l’hypothèse du temps comme constante sphérique. « Il n’est pas sûr que ce défi s’insère dans un processus d’entertainement work. L’humour carnavalesque dissimule probablement l’inquiétante question de l’entropie et de l’usure indissociable de toute trajectoire humaine. »
Mais l’approche de Zappa, pour être fondamentalement métaphysique, ne quitte jamais la plus grande lucidité sur les conditions d’existence de l’espèce humaine : le contraste entre les deux premiers morceaux du disque, l’arrangement baroque et excentrique de Inca Roads et la sécheresse déplaisante de Can’t afford no shoes, fait toute la puissance d’une discographie qui ne cesse de résister au caractère apathique de la contemplation cosmique et au sommeil dogmatique des hippies. C’est en étant radical contre son époque que Zappa l’a si bien décrite. C’est en étant sans pitié contre les gourous et les réappropriations occidentales de la pensée indienne ou zen qu’il a retrouvé l’énergie polémique et comique des grands penseurs indiens et zen. Enfin, c’est en étant d’un antichristianisme et d’un anti-autoritarisme sans faille qu’il a rempli les conditions d’une reviviscence moderne de l’espace symbolique et cryptographique de la Renaissance hermétique. « Zappa prévoit la trajectoire d’effondrement du capitalisme, écrit Darol, la mort du petit cheval qui portait le message de la fortune pour tous. » Dans une phrase comme celle-ci, le style de Darol est contaminé par son sujet : il se met lui-même à utiliser la technique de la « Continuité Conceptuelle » – car on ne peut pas alors ne pas penser au Deathless Horsie et donc au Cheval sans Mort – un des instrumentaux les plus sombres, délicats et valeureux de Zappa – signe probablement que la mort du capitalisme sera la plus longue et la plus lente des morts, à l’image du dernier homme nietzschéen, qui, étant le dernier, sera celui qui vivra le plus longtemps…
Guy Darol le remarque : l’envol du Sofa comme la création du Zodiaque Zappien s’appuie imaginairement sur la destruction de la ville d’Hollywood. « Des signes comme l’invasion des fourmis géantes, la chute des maisons et de leurs habitants, suggèrent le tournant d’une époque. » On retrouve dans One Size Fits All un désir de destruction analogue à celui d’Uncle Meat, dans ce synopsis de film jamais tourné où un savant fou, utilisant des technologies volées dans les laboratoires secrets du gouvernement, décide de détruire la Terre à l’aide d’une armée de mutants (influence probable des « théories du complot » fleurissant autour du projet MK-Ultra et de ses « magnétophones humains », auquel Zappa a d’ailleurs toujours – ne serait-ce que dans son analyse du L.S.D. – accordé un crédit certain). Malgré son caractère alcyonien et joyeux, One Size Fits All est indissociable de la grande collection des apocalypses zappiennes, ses rêves fous de guerre totale entre les hommes de pouvoir et les monstres (ou les musiciens) : 200 Motels, Joe’s Garage, Thing-Fish, Civilization Phaze III…
Bien sûr, au centre de One Size Fits All, comme précédemment dans Overnite Sensation et Apostrophe (’), il y a le chien de la « Continuité Conceptuelle ». C’est ici Evelyn, un chien « modifié » (donc rendu monstrueux) qui se souvient. Et ce dont Evelyn se souvient, c’est de Lumpy Gravy et des petits êtres réfugiés dans un grand piano, tissant un lien supplémentaire entre cette révélation centrale qu’est One Size Fits All et ces piliers d’entrée et de sortie de l’œuvre que sont les phases successives de la Trilogie : We’re Only In It For The Money, Lumpy Gravy, et Civilization Phaze Three. Le grand piano en question est, le dit très bien Darol, « un lieu de refuge » (la musique de Zappa en est un autre) : ce lieu est analogue aux territoires désertés où s’abritent de la peste les jeune gens du Decameron de Boccace. Darol rappelle qu’au cœur de la critique du flower power qui éclate dans We’re Only In It For The Money, il y a également la traque des nouveaux fascismes : le dernier morceau du disque – The Chrome Plated Megaphone of Destiny – annonce la remise en marche des camps de concentration ayant reçu à partir de 1942 les citoyens américains d’origine japonaise. De cette déplaisante prémonition, Zappa ne tire jamais une analyse morale ou un plaidoyer humaniste : au contraire, il dégage de son terrible pessimisme une énergie extraordinaire qui doit se transmettre dans une universalisation du concept de « réfugiés ». Si nous sommes fidèles à la vision de Zappa, nous devons nous comporter comme si le pouvoir nous était à jamais refusé. Si nous sommes fidèles à la vision de Zappa, nous devons nous comporter comme si la Terre avait été soumise à un contrôle gouvernemental total, dont nous sommes les exclus et les exilés. Et si, comme le dit Louise Michel, « le pouvoir est maudit », alors nous devons nous réjouir d’en être à jamais séparés et tracer notre Grande Politique sur les ruines de son règne, pour découvrir de nouveaux espaces qui n’existaient pas auparavant, à travers lesquels nous exprimerons notre puissance d’être, d’aimer et d’expérimenter. On retrouve, dans l’univers de Zappa, une ligne de démarcation similaire à celle tracée par les romans de Thomas Pynchon entre les vivants (les paumés, les joyeux, les prétérites) et les morts (les tyrans, les pervers, les nazis et les nixoniens). Elle tient à cette sensation fondamentale : les vivants savent toujours que le monde excède ce que l’on sait de lui, tandis que les morts pensent que le monde est ce qu’ils en connaissent et ce sur quoi ils peuvent exercer leur pouvoir.
Le contrôle et la transcendance sont les armes des morts (« Them »), la magie et l’art sont celles des vivants (« Us »). « One Size Fits All, peut enfin dire Guy Darol, met en scène l’éternel combat entre les forces transcendantes et la réalité magique de l’art en mouvement. Dieu possède une main trapue. Il tient le cigare de la satisfaction. Mais le bilan de ses œuvres se résume en un mobilier que l’on trouvera tantôt dans un coin de cuisine, tantôt dans un coin du salon. Au contraire, l’artiste aux doigts fins est susceptible de, produire par simple éjection de couleurs l’équivalent d’une nébuleuse possédant un diamètre de onze années-lumière. » Car si alchimie il y a, c’est malgré tout dans la mesure où celle-ci s’accompagne d’un vaste appareil de guerre anarchique – sapant d’avance toute prétention à la préséance divine qui ne soit celle d’un dieu fou et méchant, quand ce n’est pas un vulgaire milliardaire préparant un film porno au plus haut des cieux (avec sa petite copine et un cochon). Zappa partage avec les gnostiques, William Blake et Antonin Artaud une vision fondamentalement pessimiste du Créateur, une image de notre monde comme la production grotesque d’un dieu grotesque et contre lequel nous ne devons cesser de nous battre pour conquérir notre liberté.
« Je crois que notre puissance vient de notre incertitude, déclare une voix à la fin de Civilization Phaze III. Si nous savions, nous nous ennuierions, et nous ne pourrions espérer aucune puissance de cela. » À quoi une autre voix répond : « Par exemple, si nous savions ce qu’est notre musique, l’un d’entre nous pourrait parler et tout serait fini. » C’est peut-être le seul point qu’on peut chipoter à Zappa et le nouveau livre de Guy Darol nous en donne, plus que jamais, l’occasion. Bien au contraire, le fait qu’on ne cesse de parler de « notre musique » est le signe que nous ne savons pas encore ce qu’elle est. Dès lors, la fin de celle-ci – écoute comme exégèse – n’est pas pour demain et se confond avec la fin de cette civilisation mortifère dans laquelle l’humanité s’est engagée, depuis son basculement dans le monothéisme et l’État, c’est-à-dire depuis qu’elle s’est choisie et un dieu et un maître. Frank Zappa est un rendez-vous d’anarchie.